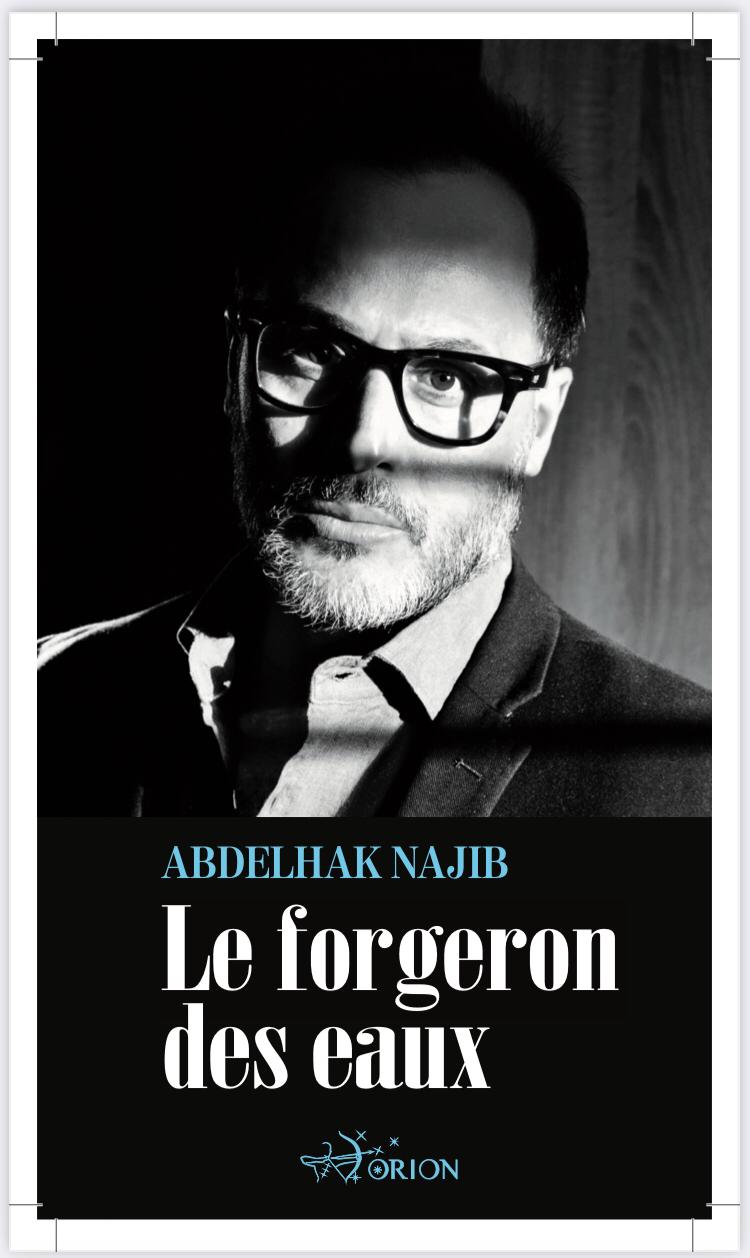
Le philosophe et journaliste, Abdelhak Najib, vient de boucler sa trilogie en aphorismes avec un nouvel essai, publié aux Éditions Orion, intitulé : «Le forgeron des eaux», qui vient compléter le cheminement entrepris dans «Inhumains» et «La vérité est une zone grise». Un condensé de pensées au hachoir sur l’homme, la vie, l’existence, le monde, l’espoir et la tragédie humaine. Un essai prophétique.
Par Docteur Imane Kendili (écrivaine et psychiatre)
D’emblée, le ton est donné dans ce dixième essai de philosophie de Abdelhak Najib, qui poursuit ici le travail entrepris dans «La rédemption par le péché», «La dignité du présent» et «Et que crève le vieux monde». Une profonde réflexion sur l’humanité, sur la débâcle de l’homme, sur l’effondrement des grandes valeurs, sur les ratages d’une humanité larvaire et aux abois, sur la mort de tout idéal d’élévation pour un homme rongé par la matérialité et la vacuité, dans un monde transfiguré en piteux spectacle numérique et digital.
En lambeaux
Abdelhak Najib nous dit qu’il «faut une sacrée dose de courage et de folie pour être cet homme dont la vie n'est qu'une lutte pour l'existence avec la certitude d'être vaincu. Il faut porter en soi l’airain des irréductibles, le peu qui demeure de ces vaillants guerriers qui résistent et refusent de céder, ne serait-ce qu’une once de leur territoire à cette modernité échevelée qui tombe en lambeaux.» Il nous répète qu’il «faut être conscient dans sa chair qu’il n'y a qu'une erreur innée, celle qui consiste à croire que nous existons pour être heureux», comme le précise Arthur Schopenhauer, l’auteur de «Le monde comme volonté et comme représentation.» Et cette erreur est rectifiée au fil des âges qui défilent, avec leur lot de dépassement de soi dans la résistance face à ce qui abrutit, à ce qui rabaisse, à ce qui fait miroiter un faux avenir. «Car l’unique futur qui vaille est celui qui se dérobe en continu. Les hommes qui croient en la lutte de chaque instant pour rester debout face à la machine qui broie et aplatit tout sur son passage, tournent le dos à ce que les autres appellent richesses et biens. Ils ne veulent rien posséder. Mieux, ils cèdent tout aux autres et se contentent de peu», précise Abdelhak Najib. Ce strict minimum pour tenir jusqu’à la fin, sans jamais quémander ni se rabaisser pour survivre. Ces hommes rejettent toutes les offres qui les impliquent dans cette mascarade nommée vie, avec son lot d’arrangements avec soi et les autres pour avoir, détenir, posséder et finir par ressembler au voisin comme deux gouttes d’eau. Les mêmes préoccupations habitent ces semblables, avec l’argent et le cumul des sous, en premier lieu. Puis, les autres attributs de l’échelle sociale que sont le véhicule, les gadgets et le logement démesuré qui finit par devenir la prison dans laquelle pourrissent les rêves avortés et les fausses joies. Alors que cet homme irréductible se préoccupe du savoir et de la connaissance. Il veut apprendre avant que la mort ne pointe son nez. Il veut approfondir ses connaissances. Il veut nourrir son esprit, son cœur et son âme de beauté et d’art : «Les hommes sont mille fois plus acharnés à acquérir des richesses que la culture, bien qu'il soit parfaitement certain que le bonheur d'un individu dépend bien plus de ce qu'il est que de ce qu'il a», résumait Arthur Schopenhauer. Cet homme est. Il revendique sa différence. Il refuse d’être le semblable de l’autre. Il sait qu’il est un individu, et en cela, il doit travailler à être unique et à le devenir constamment.
La grande solitude
«Cet homme vit en solitaire. Il n’adhère à aucun dogme. Il n’appartient à aucune paroisse. Il cultive le silence là où les autres vocifèrent. Il avance d’un pas certain sans se presser, sans jeter un œil à la frénésie qui l’entoure et tente par tous les moyens de l’attirer dans ses sillages stériles. Il marche et il n’emprunte la voie de personne. Mais il invente la sienne, au fur et à mesure qu’il crée son chemin, avec ses arrêts, ses raccourcis, ses culs-de-sac, ses routes parallèles, ses carrefours, ses demi-tours et ses errances. Il ne veut s’établir nulle part. Il refuse qu’on lui assigne une adresse. Il fuit la foule. Il n’écoute aucun chant de sirène. Il invente ses chants pour célébrer son retrait de cette mascarade orchestrée par tous les bonimenteurs, les contempteurs et les beaucoup-trop-nombreux. Il reçoit le bien comme il accueille le mal», insiste Abdelhak Najib. Oui, cet homme s’ouvre à ce que la vie apporte dans ses sillages sans se plaindre pensant toujours que cela peut toujours être pire, et c’est tant mieux, parce que cela renforce l’airain dont il est pétri : «L'homme qui reste calme dans les revers, prouve qu'il sait combien les maux possibles dans la vie sont immenses et multiples, et qu'il ne considère le malheur qui survient en ce moment que comme une petite partie de ce qui pourrait arriver.» Toujours ce pire qui raffermit. Toujours ce risque grandissant qui met à l’épreuve. Toujours ce danger qui croît et avec lequel croît également ce qui peut sauver. Cet homme est en adéquation avec ses idées les plus puissantes qui sont des credo de vie, qui sont un mode d’être à cette existence frugale qu’est la sienne. Cet homme est en règle avec ses pensées qui ne sont pas des convictions, mais des expériences continues à l’épreuve des jours. «Cet homme n’a peur de rien parce qu’il n’a rien à perdre. Il ne veut plaire à personne. Il ne veut séduire personne. Il n’appelle l’admiration de personne. Cet homme ne perd jamais son temps. Il s’emploie à étudier. Il travaille sur lui-même. Tous les jours. À tous les instants. Cet homme ne veut l’exemple de personne. Il ne donne aucun conseil. Il abhorre les leçons de morale. Il refuse la posture du faux savant qui distribue des préceptes à tour de bras», ajoute le philosophe qui construit ici une considérable œuvre philosophique, bientôt complétée par trois essais majeurs et de belle facture : «Nietzsche : l’éternel retour», «Schopenhauer et le sens du tragique humain» et «Alchimie : de l’ombre à la lumière», toujours aux Éditions Orion.
Une santé d’airain
Abdelhak Najib avance sur sa lancée pour nous signifier l’importance de cet homme qui vit à même le coeur avec cette vérité suprême : aucune fausseté, aucun faux-semblant, aucune dissimulation, aucun stratagème, aucun artifice. Et quand le mal frappe, il le reçoit avec calme et en supporte les piqûres et les morsures. En cela, il ne se change pas en assassin, en criminel, en vengeur assoiffé de rendre mille coups pour un. Non, il reste lui-même, dans la félicité et dans la douleur. Il n’a qu’un visage, le sien, le seul, celui de sa trajectoire : «L'homme est au fond une bête sauvage, une bête féroce. Nous ne le connaissons que dompté, apprivoisé en cet état qui s'appelle civilisation : aussi reculons d'effroi devant les explosions accidentelles de sa nature. Que les verrous et les chaînes de l'ordre légal tombent n'importe comment, que l'anarchie éclate, c'est alors qu'on voit ce qu'est l'homme.», ajoutait ce même Arthur Schopenhauer, qui en connaît un large rayon sur les tréfonds de l’âme humaine. Cet homme porte en lui la bête féroce et l’homme du savoir. Il travaille à unir ces deux parallèles, mais il ne cache aucun dessein malheureux pour se transformer en prédateur quand tombent les masques de la pseudo civilisation, de la fausse vie en société. C’est pour cela que cet homme ne participe jamais à ce que fait la cité, avec grand renfort de fanfares et de cors stridents. La stratégie du choc dont il participe l’oblige à se tenir à l’écart de l’hypocrisie qui régit les affaires humaines, avec tout ce que cela implique comme mensonge, comme trahison larvée et comme opportunisme. Cet homme tourne le dos à tous les conciliabules de spectres fomentés dans la cité pour flouer les autres, leur vendre de la camelote en faisant de la réclame sur le dos des crédules. Cet homme a le don de reconnaître tous les vendeurs. Il sait débusquer les âmes commerçantes. Il les flaire de loin tous ces charognards qui font bombance de toute barbaque. Il les entend de très loin toutes ces voix qui appellent à former des conglomérats de fantômes avides de tout. Cet homme porte en lui un feu sacré, celui des anciens temps, de ce temps premier où les hommes vivaient pour parcourir la terre et ses dangers, passant d’un col à l’autre, d’une cime à l’autre. C’est de ce type d’homme qu’a parlé Zarathoustra : «L’enchanteur parut à l’heure fatidique, L’ami de midi, Non ne demandez pas qui il est Il était midi, quand un est devenu deux.» C’est cet ami qui vit avec le zénith tous les nadirs du cœur, avec cette constance dans le changement. Ne jamais être une copie de soi et ne jamais demeurer le même. Car, il doit changer. Il doit se transformer en continu. Il doit transmuter. Il doit demeurer l’ami qui appelle au défi de ne jamais s’installer dans aucun ordre établi. Cet homme devient si léger qu’il s’élève avec le vent qui souffle. Cet homme aime le grand froid qui revigore. Il veut parcourir ses lointaines contrées où l’air est cinglant. Il marche vers le Nord avec cette volonté d’embrasser le gel qui le transit et laisse couler des gouttes de bienvenue. Cet homme appartient à demain, à tous les lendemains, qui finiront par arriver quand le monde aura soldé le compte de sa chute. «Peut-être, ces âmes futures connaîtraient-elles comme un état ordinaire ce que jusqu’alors ne se produisit que par moments dans nos âmes comme une exception ressentie avec frisson : un mouvement incessant entre le haut et le profond et le sentiment du haut et du profond à la fois telle une constante montée sur des degrés et tel un repos sur les nuées.», écrivait Friedrich Nietzsche dans son «Gai savoir». Cela répond à une exigence primordiale : avant d’arriver à monter les cimes, dans de folles transhumances, il faut assister au spectacle hideux de ces bouffons qui se disloquent sous le poids de leur mensonge à la vie. «Quiconque est de ma race aura pour premiers compagnons, des cadavres et des bouffons», lit-on dans le Zarathoustra. Oui, il faut les enjamber même en boîtant et avancer vers cette étendue vierge où tout reste à découvrir. Cet homme, qui arrive en ce moment à l’orée du pays inconnu, sait que les frontières sont intérieures et que celui qui a le cœur de s’aventurer peut alors espérer se trouver à tous les détours. Cet homme sait aussi que plus il monte, plus il respire.
Géographies humaines
C’est un homme de l’air frais et pur. Il se nourrit de cette brûlure froide qui pénètre la peau et touche le sang. Cet homme y va seul : «Voulez-vous monter haut ? Servez-vous de vos propres jambes. Ne vous faites pas porter sur la hauteur, ne montez pas porté sur le dos ou sur la tête d’autrui. Mais toi, tu es monté à cheval ? Et maintenant tu trottes allègrement vers ton but ? C’est bien, mon ami. Mais ton pied bot t’accompagne, sur ton cheval. Une fois arrivé à ton but, une fois descendu de cheval, c’est sur ta cime, homme supérieur que tu trébucheras.» Et il faut trébucher, parce qu’il te faut refaire ce chemin, encore et encore. Il faut tomber parce qu’il te faut te relever, encore et encore. Il faut fermer les yeux, parce qu’il te faut mieux voir encore et encore. Il te faut mourir pour renaître encore et encore. Et dans toutes ces renaissances, tu devras débusquer en toi ce diable simiesque qui en veut à ta légèreté et à tes voisinages: «O Zarathoustra, regarde-toi en ce miroir, et ayant jeté les yeux sur ce miroir, je poussai un cri et mon cœur frémit, car ce n’était pas moi que je voyais mais la face grimaçante et le rictus d’un diable». Ce miroir est le sens même de cet essai. Il est le rappel constant de ce qui se trame dans cette vie où l’on balance entre qui nous sommes et qui nous ne devrions jamais devenir. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre que nous avons besoin d’un forgeron des eaux, infatigable et déterminé à sillonner toutes les géographies humaines, sans jamais s’établir nulle part. C’est là l’unique limite que cet homme accepte pour tous ses parcours, avec leurs crêtes et leurs crevasses. Il sait qu’il est né pour être un sauteur de cimes et jamais ce diable qui fait tomber les autres. Il n’est pas non plus celui qui montre le chemin aux autres. Il est celui qui dit que chacun devra trouver son chemin, et s’il n’y arrive pas il doit l’inventer de toutes pièces. Il est celui qui n’oublie jamais que le diable rôde dans les parages. Il attend et guette. Il veut entrer en scène avec fracas : «Je savais depuis longtemps que le diable me ferait un croc-en-jambe». Et je le laisse faire. C’est cela le sens même de l’acceptation. C’est cela vivre.
*«Le forgeron des eaux». Abdelhak Najib. Editions Orion. 140 pages. Janvier 2022.